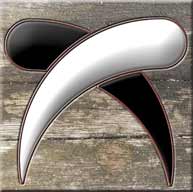-

15 novembre 1983
La messe noire
C’était une messe noire dans une petite église de campagne. La voûte était sombre et basse, les hommes étaient sombres et las.
Il m’avait fallu traverser la ville éventée pour parvenir en ce funeste sanctuaire. J’avais marché sous les bourrasques de vent accrocheuses… qui semblaient vouloir me retenir loin de cette vieille porte de bois devant laquelle j’avais échoué. Les arbres s’étaient soudainement agités, ils avaient lancé leurs multiples appendices jusqu’aux cieux et en avaient extrait un éclair blanc… Mais ma curiosité avait été plus forte que leurs recommandations muettes… et j’étais entré. J’avais eu du mal à ouvrir la porte si lourde. Maintenant encore je sens la fatigue dans mes muscles. La porte avait cédé avec un grincement de cinéma. J’étais entré et elle s’était clos dans mon dos.
Je m’étais aperçu de l’état pitoyable de ma tenue. Il pleuvait dehors : de grosses gouttes qui frappaient encore la vieille porte de bois. J’étais trempé jusqu’aux os et mal à l’aise.
J’avais ensuite pris le temps de prospecter alentour : un escalier aux grosses marches de pierre s’ouvrait devant moi. Il descendait sur une dizaine de mètres dans l’obscurité et aboutissait sur un couloir mal éclairé. Je voyais une lumière blafarde et tremblante comme une flamme, je n’y croyais alors pas encore. J’étais descendu, c’était la seule issue. Et je m’étais plongé dans le rêve.
C’était un éclairage de torches, je l’avais aperçu du haut des escaliers, longtemps dans le passé, très loin dans la clarté du passé. En descendant je n’avais plus senti l’humidité des vêtements collants à ma peau. J’avais été surpris d’arriver si rapidement dans le couloir et j’avais trébuché en y posant un second pied. J’avais vu la dizaine de mètres d’une galerie de pierres massives, claires et jaunies, éclairée de-ci de-là par de longues torches obliques. Je m’étais avancé pas à pas dans ce long défilé, passant les torches une à une… une à droite… une à gauche… une à droite… une à gauche… une à droite…
Le couloir se terminait en une alcôve noircie par les feux de l’enfer, j’avais aperçu l’ouverture arquée du fond, à gauche. Si près de ces feux de l’enfer qui noircissaient l’alcôve. Et j’avais entendu la musique. J’avais voulu m’approcher plus vite de l’entrée mais mes jambes n’avaient pû m’obeir.
Je suis maintenant dans l’encadrure de l’entrée à gauche de l’alcôve. Le passé est si loin derrière. Il y a des hommes noirs et las penchés sur un socle noir et bas. L’un d’eux me regarde surpris. Je ne vois que ses yeux sous sa cagoule (des yeux si clairs…). Je n’ai pas envie de partir, peut-être le devrais-je. Où est cette musique que j’entendais tout à l’heure… avant ? Elle est dans ma tête, elle est entrée dans mon corps, elle est en moi, elle m’anime. L’homme, forme noire devant moi, me fait signe d’avancer. Je pénétre dans la salle sombre et voutée, entouré de formes sombres et voutées. J’avance, je marche, la clarté du passé est derrière moi. Je suis entouré de sombres formes qui profèrent de sombres paroles sous une sombre voûte gardée par les feux de l’enfer, et je ne veux pas fuir. Ils ont tous les mains posées sur le socle noir… moi aussi… je ne sais pas. Il me semble sentir sous ma paume la surface lisse et froide de la pierre noire. Mes yeux se ferment, mes jambes fléchissent. On me prend sous les bras, on m’allonge sur le socle. J’ouvre les yeux : la voûte basse (ils m’ont couché pour me reposer sans doute et je m’endormirais bientôt avec cette musique qui me berce…). Un visage encapuchonné apparait à gauche, au niveau de mon menton (il a les yeux si bleus…). Un autre s’approche à droite. Ils me regardent. Celui de droite porte un long couteau, un très vieux coutelas. Que veut-il faire de ce coutelas ? Les deux formes noires se regardent, elles le tiennent maintenant ensemble au-dessus de mon sternum. Une flamme y brille, elle semble pendre au milieu de la voûte (je me sens si bien dans la tiédeur de mes vêtements mouillés, allongé dans la musique…).
Je ferme les yeux, j’aperçois la clarté du passé, je ferme les oreilles, j’entends le silence du passé, je ferme le nez, je sens la neutralité du passé, je ferme la tête et je pense la réalité du passé. J’ouvre les yeux, les oreilles, le nez et la tête et je vois le couteau, j’entends les cloches, je sens la drogue et je pense à la mort. Je veux me lever mais la porte a trop fatigué mes muscles, des scellés me tiennent cloué sur le socle noir. Mon abdomen se déchire et se redéchire. Je chavire. J’étais si bien sous la pluie… Je suis bien ici aussi, nulle part. Pauvres pantins qui martèlent mon corps, que la médiocrité vous emporte.
C’était une messe noire dans une sombre alcôve.
Une messe avec de sombres formes et des cloches.
Je me souviendrais longtemps de cette sombre alcôve.
Et de la musique envoûtante de ces cloches.
-

1er novembre 1983
Le parking
Je suis sur un parking d’autoroute, et il pleut…
Il pleut à torrent…
Il pleut des hallebardes.
Je marche sur le bitume mouillé et, de ce fait, luisant. Les voitures passent en faisant voum-tsoum sous la pluie. Leurs phares m’éblouissent un peu mais je ne m’en préoccupe pas parce que je suis mouillé. Devant moi il y a la station d’essence et le magasin qui va avec. Je marche vers eux mais je crois qu’ils ne m’ont pas encore vu. J’enfonce les mains dans ma parka et j’y rencontre les miennes. Ce sont peut-être les mains de Marion que j’ai enfoncées. J’ai dû les lui couper tout à l’heure. Peu importe, j’éjecte les mains intruses. Elles s’en vont sans bruit.
Je me suis rapproché du magasin qui est une brasserie. Les vitres sont très grandes et pleines de buée. Il n’y a personne dans la station car à cette heure, et puisqu’il pleut, tout le monde rentre chez soi. Je suis seul au bord de cette autoroute, moi qui suis à pied, sous la pluie. Il n’y a même plus d’étoiles dans le ciel, elles ont dû tomber. Je les plains de devoir parfois briller pour moi et de tomber quand je ne les regarde plus. Sur ma droite il y a des arbres, qui sont mouillés et seuls eux aussi. Ils sont seuls car ils n’ont jamais pu se frotter les uns contre les autres. Il n’y a que les vaches qui se frottent contre les arbres, une vache ce n’est pas un arbre… Je crois que les arbres pleurent car les gouttes qui en tombent sont plus grosses que les gouttes du ciel. Les arbres complotent quand il y a du vent et pleurent sous la pluie.
Le vent lui aussi complote, et le ciel pleure en même temps que les arbres. Peut-être sont-ce les étoiles qui pleurent en ce moment, parce que je ne les regarde pas. Je les regarde. Elles ne pleurent plus.
Le silence est tombé sur la station service illuminée. Les arbres dégouttent leurs dernières larmes. Les voitures font plus de bruit maintenant, mais un bruit moins embêtant qu’avant. Par contre les phares me gênent, maintenant que je ne suis plus occupé par la pluie. Je me suis considérablement rapproché de la taverne aux baies vitrées embuées, en fait j’en suis tout proche maintenant. Je crois entendre le bruit à l’intérieur, mais je crois aussi qu’il m’est impossible de l’entendre à cause du vrombissement des voitures. Elles continuent de filer dans mon dos, elles se moquent de ce qui se passe ici. Il y a un trou dans la buée qui ne permettra de regarder à l’intérieur de l’auberge. Je m’approche, lentement parce que je ne suis pas pressé et doucement pour ne pas être vu. Je ne veux pas être vu, je veux rester seul. Je regarde la salle de l’autre coté de la vitre qui m’en sépare. Il y a beaucoup de fumée à l’intérieur. Personne ne me regarde sauf un homme d’une cinquantaine d’années. Il a les cheveux grisonnants, bien arrangés. Il est assis à une table ronde et il n’y est pas assis seul. Mais les autres ne comptent pas, c’est lui qui me regarde. D’ailleurs je le regarde aussi. Nous nous regardons. Je pourrais tourner les yeux et regarder ailleurs, mais je ne le fais pas. Je pourrais aussi entrer et lui demander avec arrogance pourquoi il me regarde, mais je ne le fais pas non plus. Je suis fatigué, je le regarde machinalement. Je le regarde toujours, il me regarde encore. Je crois qu’il commence à être indisposé, comme moi. Il est indisposé mais ne baisse pas le regard. Les autres hommes ne comptent pas, pas plus que les voitures et la pluie qui recommence. L’homme va se lever, je le sens. Il se lève. Il porte une parka marron, comme moi. Je ne vois pas ce qu’il porte dessous, je m’en moque. Il a des chaussures noires. Il s’est levé sans cesser de me regarder, il s’est cogné au bord de la table. Les autres ont levé la tête mais replongent vite dans leurs verres. Il marche. J’entends ses pas silencieux. Je crois que je sue. L’homme se déplace parmi les autres. Il me regarde. Il s’est approché du bar et s’y est accoudé, je ne sais pas pourquoi. Il me regarde à travers la fumée qui bouge, qui l’entoure, qui l’avale et le recrache. Ses yeux grandissent, ils s’élancent et galopent vers moi, et en fait ses yeux sont des gouffres. Très vite, ils me mangent.