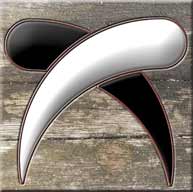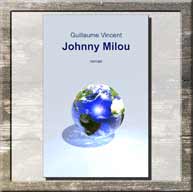29.
Nous devons partir demain, ce serait bête de se faire attraper.
Je ne sais pas où est Vania. Je dois la rejoindre en Italie, sur les rives du lac de Côme, nous avons décidé de partir. Mais à cet instant, je ne sais pas où elle peut être… J'espère qu'elle ne rencontre pas les mêmes problèmes que moi…
J'ai à peine le temps de souffler un peu, j'entends de nouveau leurs pas qui résonnent sur le bitume. Et l'ambulance qui tourne sec dans les petites rues du quartier.
Ils me cherchent. Ça fait une bonne heure que ça dure, et je suis exténué. Mais je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas faiblir, je dois continuer à courir pour être en Italie demain.
Nous avons convaincu Hermès de nous laisser quitter la Terre pour vivre quelques années sur une planète déserte, comme dans mon rêve.
Vania n'est pas enthousiaste, mais la curiosité l'a tout de même emporté sur le doute. Elle a préparé ça comme des vacances. Elle a même acheté une valise entière de pellicules photo, pour ne pas manquer.
Ma préoccupation du moment est de rejoindre la gare. Arriver à prolonger ce jeu du chat et de la souris jusqu'au petit matin, jusqu'au départ du train.
C'est le train de la liberté. Je l'imagine, fumant et sonore, comme les trains des vieux films de guerre, ceux qui ramenaient les héros blessés chez eux, dans leurs foyers.
Mon foyer est loin. Quel foyer ? Ce petit studio dans lequel j'ai traîné ma vie. Une dizaine d'années glauques avant d'échouer dans un hôpital pour gens pas normaux.
Non, je cours dans la rue, sous la pluie, une ambulance me poursuit, mais je ne suis pas fou. Juste un peu hors de la normale, peut-être. Mais un tout petit peu seulement.
Si je courrais nu sous la pluie, je serais fou. Ce n'est pas que l'idée me rebute, ni même qu'elle ne me séduise pas, c'est qu'on ne me laissera jamais monter dans le train tout nu.
Mon foyer brûle. J'y suis repassé cet après-midi, tout l'immeuble était en feu. Des flammes doivent encore lécher les quelques preuves de mon existence sur terre. Je n'ai plus de papiers, je n'ai plus d'histoire. Et je n'ai plus d'avenir ici, au-delà de demain, au-delà du voyage en train et du taxi qui me mènera au lac.
Essoufflé, je me réfugie sous un porche. La pluie est froide. Elle me fouette le visage et coule le long de mes cheveux jusque sous ma veste. Je m'adosse au mur de pierre, la tête posée sur le digicode comme sur un oreiller vertical.
Dans la lumière des lampadaires, on voit les traits de pluie blancs se détacher sur la nuit d'encre. Ça fait comme des milliers de barreaux. Nous sommes dans une prison gigantesque, dans une cellule minuscule. Ce sont de très fins barreaux. On pourrait courir les bras écartés, rien que pour le plaisir d'en rompre un paquet. Mais ils sont trop nombreux, et toujours renouvelés.
Derrière la porte il y a des habitations, probablement. Des gens qui vivent, peut-être juste derrière cette pierre. Je pose ma main dessus, pour voir si une chaleur humaine s'en exhale, mais je ne sens rien, juste l'humidité de la pluie. Ces gens, je ne les connais pas. J'aurais certainement aimé les connaître, mais ça ne s'est pas produit.
Sous les quelques gouttes de pluie obliques, celles qui arrivent à atteindre la porte, je suis seul au monde. Le monde me rejette. Ou plutôt il me heurte tellement que je ne peux y rester.
Ce n'est pas moi qui pars, c'est la société terrestre qui m'expulse, comme une déjection qui ne peut plus rien apporter au corps qui l'a produite. C'est mécanique, vital, un simple mécanisme de protection qui évite le pourrissement.
À notre époque, pour vivre, il faut gagner. Je n'ai jamais bien compris quoi, mais il faut gagner. Socialement, c'est très bien vu. Pour commencer, il faut perdre sa vie à la gagner. Ensuite il faut gagner l'estime, l'amour, et tous les combats que des abrutis viennent vous proposer.
Et il est aussi conseillé de bien regarder la télé pour suivre les tendances de la normalité. Il y a dix ans, c'était vraiment de bon ton de fumer comme un pompier, maintenant il est beaucoup plus porteur, socialement, d'arrêter de fumer. Le fumeur qui arrête est un héros moderne, un mec qui a tout compris.
Il faut être normal, sinon la digestion commence et on finit en déjection de l'organisme social. Un individu normal gagne forcément.
Je n'ai jamais rien gagné et, depuis que j'ai rencontré Hermès, il m'est totalement impossible de m'approcher à moins d'un parsec de la normalité sociale.
Je pourrais être fou. Pour la société terrestre ce serait pratique de dire que je le suis. Je pourrais me faire soigner, lisser mes souvenirs, élaguer toutes ces idées qui dépassent du cadre scientifique reconnu et du cadre libéral imposé.
Si les psychanalystes avaient existé à son époque, Jésus-Christ aurait sagement fini sa vie de charpentier, après une bonne thérapie.
Mais je ne suis pas Jésus, alors je dois être fou.
Je cours comme une bête traquée dans les rues mouillées de la ville hurlante. Les sirènes des ambulances se croisent autour de moi, matérialisant un filet qui se resserre. C'est une chasse à courre.
Il est certainement fou d'imaginer que l'humanité est une notion qui dépasse la Terre, que la destinée humaine est autre chose que simplement consumer jusqu'au bout les ressources de notre petite planète.
C'est fou, mais c'est beau, c'est grand. Ça me donne plus envie de vivre.
Découvrir la galaxie est une perspective plus attrayante que de passer une soirée devant le dernier programme de télé-réalité.
Alors je ne vois vraiment pas pourquoi Vania hésite.
En recommençant à courir, parce que les ambulances se rapprochent, j'espère une fois de plus qu'elle ne va pas changer d'avis.
Parmi les taches de lumière mouvantes qui se reflètent sur le bitume noir et luisant des trottoirs, j'aperçois une bouche de métro.
J'arrive tellement vite en haut des marches aux bordures métalliques, que je glisse sur la première. Un couple s'écarte pour me laisser choir tranquillement.
J'arrive en bas comme un paquet de linge mouillé dans la cour d'un pressing. Je n'ai plus de forme. Une ambulance passe en trombe juste devant l'entrée du métro, mais elle ne peut plus me voir.
C'est le chaos. Le monde est dans le chaos.
C'est le chaos dans mon cerveau. La dernière et l'avant-dernière marches résonnent encore sur mon front et ma tempe.
Le monde tourne, le monde change. Le monde tourne au-dessus de moi. J'ai atterri le dos au sol, les jambes traînant encore sur les marches. J'écarte les bras. Des passants m'évitent en essayant de ne pas me regarder, mais en regardant quand même pour voir jusqu'où un homme peut déchoir.
Ma tête a frappé dur sur le béton et maintenant tout tourne. Les lumières proches de la bouche de métro, et celles, plus lointaines, des lampadaires, décrivent des arcs de cercle tremblotants. De vastes cercles qui tournent sans cesse. Ça tourne mais c'est pourtant toujours à la même place, c'est entêtant.
J'entends une sirène arriver, se taire dans un couac et un crissement de pneus. Le manège s'arrête immédiatement, les lumières redeviennent fixes, avec les flashs bleus de l'ambulance qui se reflètent sur le haut des escaliers. Je vois à nouveau et je sens la pluie qui me tombe dessus comme un milliard de flèches en coton.
Je me lève aussi vite que je le peux, mais en dérapant sur le béton mouillé. Je m'affale sur la porte qui s'ouvre et me laisse entrer, titubant, au milieu de la station. Passer les tripodes, je n'ai pas de ticket. Allez, un effort, monter mon corps fourbu à bout de bras, se balancer sur la machine et retomber sans se casser la figure.
Ça passe juste. Mais je n'ai pas l'esprit assez clair pour voir les panneaux, alors je prends une direction au hasard. Je bouscule une passante qui me repousse violemment. Je marmonne une excuse. Elle s'écarte horrifiée et part en courant. Je ne dois pas avoir une allure rassurante.
Au bout du couloir j'entends des pas précipités dans l'entrée de la station, des hommes parlent, interrogent, donnent des ordres. Je cours en sens opposé. La proximité du danger me stimule.
Je cours au-delà de mes forces dans les couloirs quasi-déserts. À force, j'ai l'impression de passer dans un autre monde. La réalité physique s'efface. Mes jambes martèlent le sol avec une régularité étonnante. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais les arrêter. J'accélère dans les lignes droites, je tourne, j'escalade ou je dévale les escaliers sans m'en rendre compte.
Je passe en trombe dans une station de métro. Le quai est presque désert et les rares personnes qui sont là s'écartent sur mon passage, elles me regardent arriver sans trop comprendre, font un pas en arrière, et après vont au diable, je ne me retourne pas pour les voir secouer la tête.
Au bout de la station, je reprends un couloir, celui qui se présente, ou un autre, avant d'arriver au bout. Et je continue par-là, toujours en courant.
Puis, une fois, il n'y a rien au bout de la station, fatalement ça arrive. Alors je continue dans le tunnel, je longe les rails électrifiés, je dérape sur les pierres. Entre deux stations, quand la lumière de la précédente s'estompe alors que la suivante est encore trop loin pour prendre le relais, on ne voit presque plus rien. Les lumières de sécurité font seulement quelques tâches jaunes, presque marrons sur les murs noircis.
Quand j'entends le bruit du métro qui arrive derrière moi, je repère la prochaine niche, j'y cours de plus belle. Je m'accroupis dans l'antre, et je regarde les wagons passer dans un hurlement insoupçonnable pour les passagers.
Au bout du tunnel, il y a la station suivante. J'escalade les petits escaliers et je m'engouffre dedans. Voir un fou arriver, sorti du tunnel, ça impressionne tout de suite le bon peuple. Les réactions sont horrifiées, terrifiées ou statufiées, mais elles sont forcément excessives.
Par vice, j'ai traversé la station en vociférant et j'ai continué direct dans le tunnel suivant, je me demande s'ils s'en sont remis.
Comme par hasard, je finis par arriver sous la gare, j'ai dû, même inconsciemment, suivre les indications qui passaient furtivement dans mon champ de vision.
Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne derrière moi. Du moins je le crois, je n'entends rien. Non, personne ne me poursuit. Les ambulanciers doivent être rentrés se coucher.
Arrivé au bout du couloir, je ne tourne pas, je fonce tout droit sur le mur, sur un panneau publicitaire, parce qu'il faut bien que je m'arrête un jour, parce que d'un coup mes jambes se rappellent qu'elles sont faites d'os et de muscles.
Il me fallait bien ça, après une telle course. M'arrêter en douceur eut été une traîtrise. Il me fallait un butoir, un réceptacle pour cette course folle.
Ma tête s'aplatit de biais sur l'affiche, entre mes mains qui ont tenté d'adoucir le choc. Puis tout le reste du corps, jusqu'aux jambes qui s'enchevêtrent en désordre avant de se dérober. Je glisse lentement jusqu'au bas de l'affiche.
Je ne suis pas sonné, seulement fatigué. Je me suis jeté sur le mur comme je me serais jeté dans mon lit. Alors je reste plaqué contre le béton. Je pourrais me relever, m'écarter un peu, mais je préfère garder ma joue sur cet oreiller duveteux que personne ne peut voir.
La tête et les mains encore agrippées au mur, je suis affalé sur le sol. Je reprends mon souffle en haletant et en poussant de temps en temps des râles de mourant.
Une femme arrive dans le couloir, j'entends son pas ralentir, un murmure de dégoût pendant qu'elle me contourne à distance, puis ses petits pas qui accélèrent pour repartir au plus vite.
Tout en me demandant pourquoi elle exprime du dégoût, je remarque une longue traînée rouge au-dessus de ma main gauche. Je m'écarte un peu pour constater que mon visage et ma main droite ont laissé les mêmes traces.
Le sang coule de l'arrière de mon crâne. Au fur et à mesure de la course, je m'en suis mis un peu partout. Les cheveux surtout, une horreur. Mouillé, sanguinolent, essoufflé, je dois faire peur, effectivement. Je compatis. C'est la vie. La mort aussi, un peu.
Avant de prendre le train, je dois me laver, je dois me reposer. Jamais je ne pourrai affronter la foule dans cet état, on ne me laissera pas, on m'arrêtera.
Et je dois partir d'ici, aussi. La femme qui s'est enfuie tout à l'heure va peut-être avertir quelqu'un. Le sang, ça fait souvent réagir.
D'une démarche maintenant apaisée, je pars à la découverte des entrailles de la station et de la gare. J'essaie de descendre, de trouver les coins les plus reculés. Et j'essaie de passer de la zone publique à la zone réservée aux employés.
Je finis par trouver un vestiaire et des sanitaires déserts. Exactement ce qu'il me faut. Je me lave soigneusement, puis je m'installe dans un coin pour attendre l'heure du train.
Au moment de repartir, j'hésite. Je ne veux pas prendre le risque de sortir et de monter à la gare comme si de rien n'était, j'ai peur que les hommes en blanc ne m'attendent là-haut.
Je décide d'essayer de suivre le chemin du fret. Ça devrait me permettre d'arriver jusqu'aux trains en évitant la plupart des endroits où les voyageurs passent habituellement.
Je monte dans les étages, ou plutôt, je remonte à la surface, lentement. Au détour d'un couloir, j'entends puis je vois un convoi de chariots. Comme un bandit de western, je prends le train en marche, un petit train, avec de petits wagons. Discrètement, je réussis à me glisser entre deux containers métalliques.
Mon petit train fait le trajet pour moi. Une ou deux fois, ça s'arrête et je me demande s'il ne va pas falloir descendre et trouver autre chose. Je risque un œil hors de ma planque pour comprendre à quoi est dû l'arrêt. Ce n'est rien, juste le conducteur qui discute avec un collègue.
Nous arrivons dans le hall de la gare. Il est encore tôt, mais il y a plein de monde. Je me rétracte entre les containers, je m'enveloppe de mon manteau, j'espère ressembler à un sac de courrier posé là.
Dans un tournant j'ai la chance d'apercevoir un panneau d'affichage. Mon train est au quai B.
Nous sommes devant le quai F, et le train part dans cinq minutes. Mon cœur bat. L'enjeu est trop important, quoiqu'il arrive, je dois y aller, monter dans ce train. Même s'il faut se battre, pour une fois, même s'il faut mourir.
Au même instant, par les portes lointaines mais béantes de la gare, j'entends une sirène et je vois les flashs bleus qui se reflètent sur les dalles lisses. Les ambulanciers sortent en courant et se précipitent vers les quais.
Sur le quai B, le train est prêt à partir.
Ils sont derrière moi, les hommes en blanc. Et je ne peux plus rester planqué. Je ne peux absolument pas.
Je me lève, ils me voient. Ils me montrent du doigt et se ruent sur moi. Je cours, les contrôleurs sifflent le départ, à quelques enjambées devant moi une porte se ferme au ralenti. L'univers m'attend…